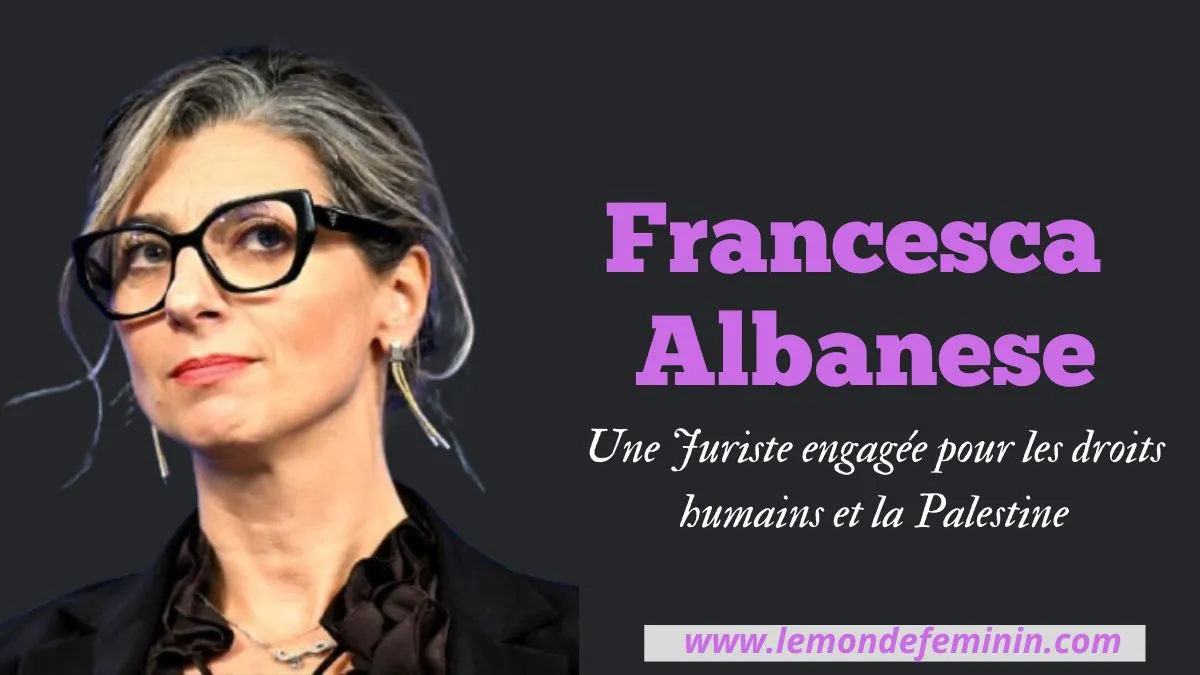Table of Contents
Francesca Albanese : Une Juriste engagée pour les droits humains et la Palestine
Francesca Paola Albanese est une juriste et chercheuse italienne, née le 30 mars 1977 à Ariano Irpino, en Campanie. Spécialisée en droit international, elle est devenue une figure internationalement reconnue dans le domaine des droits de l’homme, particulièrement en ce qui concerne les territoires palestiniens occupés. Son rôle de rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme dans ces territoires, depuis 2022, a fait d’elle une personnalité controversée mais incontournable dans les débats sur le conflit israélo-palestinien.
Parcours académique et professionnel
Francesca Albanese a suivi une formation académique solide. Elle est titulaire d’une licence en droit de l’Université de Pise, d’un master en droits de l’homme de l’Université SOAS de Londres, et d’un doctorat en droit international des réfugiés de la faculté de droit de l’Université d’Amsterdam. Ces études lui ont permis d’acquérir une expertise approfondie dans les domaines complexes du droit international, des droits de l’homme et du droit des réfugiés.
Elle a poursuivi sa carrière en tant que chercheuse affiliée à l’Institut pour l’étude des migrations internationales de l’Université de Georgetown. Elle a également occupé le poste de conseillère principale sur les migrations et les déplacements forcés auprès de l’organisation à but non lucratif Arab Renaissance for Democracy and Development (ARDD). Par ailleurs, elle est chercheuse à l’Institut international d’études sociales de l’Université Érasme de Rotterdam, où elle a cofondé le Réseau mondial sur la question de la Palestine (GNQP). Ce réseau rassemble des professionnels et des universitaires engagés en Israël, en Palestine ou sur cette question.
Son expertise s’est concrétisée par des publications importantes. En 2020, elle a co-rédigé avec Lex Takkenberg l’ouvrage Palestinian Refugees in International Law, une référence majeure sur le statut juridique des réfugiés palestiniens dans le cadre du droit international. En 2023, elle a publié aux côtés de Christian Elia l’ouvrage J’accuse : Gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo, Israele, l’apartheid in Palestina e la guerra, un ouvrage polémique qui a suscité de vives réactions.
Durant une décennie, Francesca Albanese a travaillé pour l’Organisation des Nations unies (ONU), notamment au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) et à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Dans ces fonctions, elle a conseillé l’ONU, des gouvernements et la société civile au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la région Asie-Pacifique sur les droits de l’homme et leur application, en particulier pour les groupes vulnérables comme les réfugiés et les migrants. Elle a également enseigné le droit international et les déplacements forcés dans des universités européennes et arabes, tout en participant activement à des conférences et événements publics sur le conflit israélo-palestinien.
Rapporteure spéciale de l’ONU : nomination et controverses
Le 1er mai 2022, Francesca Albanese a été nommée rapporteure spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés, pour un mandat initial de trois ans. Cette nomination, qui a fait d’elle la première femme à occuper ce poste et la deuxième Italienne après Giorgio Giacomelli, a immédiatement suscité des réactions contrastées.
Dès ses débuts dans la fonction, Francesca Albanese s’est distinguée par une position claire et critique à l’égard de la politique israélienne dans les territoires occupés. Dans son premier rapport, publié le 18 octobre 2022, elle recommandait que les États membres de l’ONU élaborent « un plan pour mettre fin à l’occupation coloniale israélienne et au régime d’apartheid ». Ce rapport concluait que l’occupation israélienne constituait « un régime intentionnellement acquisitif, ségrégationniste et répressif conçu pour empêcher la réalisation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination ». Ces propos, perçus comme très durs envers Israël, ont immédiatement déclenché une vague de critiques.
La controverse autour de sa nomination s’est intensifiée en raison de déclarations passées de Francesca Albanese. Elle avait notamment critiqué l’inaction des pays occidentaux lors de l’offensive israélienne de 2014 sur la bande de Gaza, décrivant les États-Unis comme « subjugués par le lobby juif » et l’Europe par un « sentiment de culpabilité à l’égard de l’Holocauste », arguant que tous deux « condamnent les opprimés » dans le conflit. Face à ces réactions, elle a reconnu un « choix des mots inapproprié » et précisé qu’elle visait les lobbys pro-israéliens aux États-Unis, et non les peuples juif ou palestinien.
Face aux accusations d’antisémitisme, Francesca Albanese a fermement affirmé qu’elle ne l’était pas, insistant sur le fait que sa critique était dirigée contre l’occupation israélienne et ses violations présumées du droit international, et non contre le peuple juif. En décembre 2022, soixante-cinq spécialistes de l’antisémitisme, de l’Holocauste et des études juives ont publié une déclaration soutenant publiquement Francesca Albanese, estimant que la campagne menée contre elle visait essentiellement à la faire taire et à saper son mandat. En janvier 2023, 116 organisations de défense des droits de l’homme et de la société civile ont salué ses « efforts inlassables pour protéger les droits de l’homme dans les TPO ».
Cependant, la pression s’est maintenue. En février 2023, un groupe bipartisan de 18 membres du Congrès des États-Unis a demandé sa destitution, l’accusant d’un parti pris constant contre Israël. Malgré ces attaques, elle a reçu en avril 2023 le prix international Stefano Chiarini pour son travail journalistique sur la Palestine et le Moyen-Orient.
Rapports et positions sur la situation à Gaza
L’activité de Francesca Albanese s’est particulièrement intensifiée avec l’escalade du conflit à Gaza à partir d’octobre 2023. Elle a appelé à un cessez-le-feu immédiat, avertissant que « les Palestiniens courent le grave danger d’un nettoyage ethnique de masse ». Elle a insisté sur la responsabilité de la communauté internationale pour prévenir les crimes d’atrocité et a affirmé que la responsabilité des crimes internationaux commis par les forces d’occupation israéliennes et le Hamas devait être immédiatement recherchée.
Son rapport le plus controversé à ce jour est celui publié le 25 mars 2024, intitulé Anatomie d’un génocide. Dans ce document, elle affirme qu’il existe des « motifs raisonnables » de croire qu’Israël a commis plusieurs actes de génocide dans la bande de Gaza, se basant sur les cinq actes définis dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 : le meurtre direct des membres du groupe, les dommages physiques ou psychiques causés aux membres du groupe, et la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Le rapport évoque également un « nettoyage ethnique » de Gaza.
Elle cite des chiffres alarmants : plus de 30 000 morts, 12 000 disparus et 71 000 blessés graves selon les chiffres du ministère de la santé du Hamas, avec 70 % de femmes et d’enfants parmi les victimes. Le rapport souligne également les atteintes à l’intégrité physique et mentale des Palestiniens, notamment les arrestations massives, les tortures et la détérioration des conditions de vie entraînant des risques de famine et de maladies.
Francesca Albanese accuse Israël d’avoir invoqué le droit international humanitaire comme un « camouflage humanitaire » pour légitimer la violence génocidaire déployée à Gaza. Elle affirme que les dirigeants israéliens ont traité « un groupe entier » comme s’il était « terroriste » ou « soutenant le terrorisme », transformant ainsi tout le monde en cible ou en dommage collatéral.
En réponse à ces accusations, Israël a nié l’ensemble des faits et a qualifié le rapport de partial et de déformé. Le gouvernement israélien a désigné Francesca Albanese persona non grata et lui a interdit d’entrer dans le pays.
Réactions internationales et sanctions
Les positions prises par Francesca Albanese ont suscité des réactions très polarisées au niveau international. Alors que de nombreux groupes de défense des droits de l’homme et des intellectuels la soutiennent, plusieurs gouvernements, dont les États-Unis, Israël, les Pays-Bas, l’Argentine et la Hongrie, se sont opposés à son renouvellement en avril 2025. Malgré cette opposition, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a confirmé son mandat jusqu’en 2028.
En juillet 2025, les États-Unis ont imposé des sanctions à Francesca Albanese, l’accusant d’« activités partiales et malveillantes », d’« antisémitisme décomplexé » et de « soutien au terrorisme ». Ces sanctions visaient notamment ses dénonciations des entreprises soutenant le projet colonial israélien et son opposition à un projet de déplacement de la population de Gaza annoncé par Donald Trump. Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a appelé Washington à lever ces sanctions et à cesser les attaques contre les personnalités désignées par l’ONU.
Conclusion : Une figure centrale du débat sur la Palestine
Francesca Albanese incarne une figure centrale et controversée dans le débat international sur la Palestine. Juriste reconnue et engagée, elle utilise sa position à l’ONU pour dénoncer ce qu’elle perçoit comme des violations graves et systématiques des droits de l’homme par Israël. Ses rapports, souvent virulents, alimentent les débats et polarisent les opinions. Si ses détracteurs l’accusent de partialité, voire d’antisémitisme, ses soutiens la présentent comme une voix nécessaire pour défendre les droits des Palestiniens face à une occupation qu’ils jugent illégale et oppressive.
Quels que soient les jugements portés sur elle, l’influence de Francesca Albanese sur la scène internationale est indéniable. Son travail et ses déclarations continueront très probablement de façonner le débat sur le conflit israélo-palestinien dans les années à venir, tant au sein des institutions internationales que dans l’opinion publique mondiale.